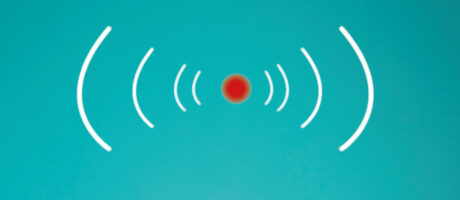La presse parle d’Afterres et des travaux associés de Solagro. Tour d’horizon des principaux articles de presse parus en 2024.
– ALIMENTATION –

La Tribune – fév 2024, « La souveraineté alimentaire, une notion politique dont la définition fait débat », « si une telle notion de souveraineté était retenue et inscrite dans la loi, « elle constituerait en effet une menace directe pour le droit de l’environnement, notamment en ce qui concerne la consommation de produits phytosanitaires et la mise en place d’infrastructures agro-écologiques (haies, prairies, zones humides, ndlr) », rétorque Christian Couturier, directeur de l’association de conseil en matière d’agro-écologie Solagro. »
Vert – fév 2024, « L’agroécologie peut-elle nourrir toute l’humanité ? », « Cela impliquerait d’abord de manger moins de viande. Les animaux d’élevage consomment environ le quart de l’ensemble des végétaux produits sur les terres cultivables de la planète. Bénéfique pour le climat et la santé, la réduction de cette consommation carnée libérerait de l’espace pour de nouvelles cultures à destination des humains. », « Cette surface supplémentaire pourra largement compenser la baisse de rendement de l’agroécologie, sans devoir créer de nouvelles terres agricoles », ajoute le chercheur. En revanche, un arrêt total de l’élevage serait inutile, voire contre-productif. « Nous avons aussi besoin du bétail pour manger ce que l’on ne peut pas manger, comme les prairies par exemple, nuance l’agronome Sylvain Doublet, co-scénariste du scénario scientifique Afterres2050 destiné à évaluer les futurs besoins alimentaires. Les déchets organiques produits par les bêtes peuvent aussi servir de fertilisant naturel. »
![]()
Le Monde – fév 2024, « Colère des agriculteurs : « Le temps est venu de produire d’abord pour nous nourrir et non pour alimenter les marchés internationaux » », « Malgré une importante surface agricole utile rapportée à ses habitants et une balance agroalimentaire positive, la France est loin de la souveraineté alimentaire, constatent les universitaires Ivar Ekeland, Dominique Méda et Philippe Pointereau, dans une tribune au « Monde ». »
La France agricole – janv 2024, « Quels débouchés pour la bio? », « La FNH a donc réalisé un travail de modélisation, avec l’appui technique de Solagro, pour estimer la part des consommations nécessaires pour absorber une production bio qui devrait atteindre 21 % de la SAU française en 2030. » d’après le rapport avec Christian Couturier et Julie Casenave
Reporterre – janv. 2024, « Les grosses marges des distributeurs plombent la filière bio », « Et si les distributeurs étaient contraints d’afficher leurs marges ? C’est l’une des propositions de la Fondation pour la nature et l’Homme pour sauver la filière biologique française. L’ONG a publié une note le 16 janvier, élaborée avec le cabinet d’études Solagro. »
Paysan Breton – Avril 2024 , « Le régime bio est meilleur pour la santé », « Pour Philippe Pointereau, agronome (ex Solagro), la consommation bio est en adéquation avec le PNNS 4 (Programme national nutrition santé), qui préfigure la consommation de demain. »
Utopia – Juin 2024, Le Manifeste « Penser et agir pour un monde habitable », « Solagro propose une « assiette » en 2050 (voir annexe 5) qui prenne en compte à la fois les enjeux sanitaires, mais également les impératifs en matière de lutte en faveur de la biodiversité et contre le dérèglement climatique. Selon ce scénario auquel nous souscrivons, en France, nous devons passer de 2/3 de protéines animales à 2/3 de protéines végétales ». […]
Youtube – Virage Énergie Climat Pays de la Loire – Juin 2024 , « Coûts cachés de l’alimentation, pour un système alimentaire résilient avec le scénario Afterres2050 » avec la présentation de Caroline Gibert
Actu.fr – Mai 2024, « Bretagne. Bio : des produits bons pour la santé du consommateur », « L’inflation a donné un sérieux coup de frein aux achats de produits bio. « Pourtant, ils sont bons pour la santé du consommateur et celle de la planète » rappelle le GAB du Morbihan. Ce n’est pas avec la PAC, la politique agricole commune, qu’on va changer les choses « . Le 19 mars dernier, Philippe Pointereau a interpelé les adhérents du GAB, le groupement des agriculteurs biologiques du Morbihan, englués dans une crise sans précédent depuis de longs mois déjà. » […]
BFM TV – Octobre 2024, « Moins de viande, nouvelles protéines, insectes: que mangerons-nous en 2050? », « Si de nouveaux fruits font en effet leur apparition dans les champs français, notamment en Normandie, « on ne s’attend pas à ce que la France métropolitaine devienne un pays producteur de bananes, d’oranges, de mangues, d’aloe vera ou de pistaches, ça restera marginal », balaie Sylvain Doublet, de Solagro. Car si les effets du changement climatique vont s’accélérer, « il faut aussi s’attendre à une augmentation de la fréquence des événements extrêmes ». […]
Le Monde – Oct. 2024, « Le pionnier du bio, Léa Nature mise sur la solidarité », « Léa Nature a contribué à créer des filières et des marques premium bio, dans le respect de l’environnement et des êtres vivants, qui permettent de produire des produits bio et naturels, à fortes valeurs ajoutées en faveur des agriculteurs engagés et de les entraîner dans sa dynamique”, estime Caroline Gibert, responsable de l’activité agroécologie et biodiversité chez Solagro, association toulousaine qui accompagne dans leur transition écologique agriculteurs, coopératives et collectivités territoriales. «
– AGROÉCOLOGIE – BIODIVERSITÉ –
![]()
Libération – janv.2024, « Agriculture et écologie – Le Champ des possibles », « Sur le papier, un système plus autonome rend les exploitations plus résilientes face au dérèglement climatique et aux hausses de charges, à l’origine de la contestation aujourd’hui. Encore faut-il les accompagner. « Même les agriculteurs qui sont dans un système vertueux souffrent de la crise. Mais changer les pratiques peut rendre moins vulnérable[…] La question, c’est comment on rémunère correctement les agriculteurs? », analyse Christian Couturier directeur de Solagro, organisme qui fait du conseil en ingénierie pour accompagner les agriculteurs vers leur transition écologique. »
![]()
Phytoma – janv-2024, « L’arrêt du glyphosate au service de l’enseignement des transitions », avec Maxime Moncamp, « L’obligation d’arrêt de l’utilisation du glyphosate sur les fermes des lycées agricoles implique une évolution des systèmes de production. Ces fermes doivent répondre à des objectifs multiples, de production, de pédagogie et d’innovation ce qui complexifie leurs perspectives d’évolution. Le projet CASDAR Glycos’EPA accompagne les équipes de 13 lycées agricoles à reconcevoir les systèmes de production de fermes de polyculture-élevage, grandes cultures, arboriculture et viticulture. «
Signé PAP – janv. 2024, « Le paysage rural aura-t-il à nouveau le goût de notre assiette? », « Soucieux d’assurer la transition énergétique et, plus généralement, la transition de nos sociétés vers le développement durable, des professionnels de l’aménagement se sont réunis en association afin de promouvoir le rôle central que les démarches de paysage peuvent jouer dans les politiques d’aménagement du territoire. Ce mois-ci, retrouvez le texte de Philippe Pointereau, ingénieur agronome et l’un des fondateurs de l’entreprise associative Solagro. »
Podcast France Culture – Avril 2024, Entendez-vous l’éco ? « Notre modèle agricole est-il basé sur une surproduction au dépens de l’environnement ? » avec les invités : Eve Fouilleux directrice de recherches au CNRS en science politique, chercheure associée au CIRAD; David Makowski directeur de recherche à l’Inra, au sein du département Environnement-Agronomie » – Eve Fouilleux explique (à 55’56) : « L’agriculture biologique pourrait être une alternative. Il y a de nombreux scénarios de prospective qui ont été mis au point par plusieurs groupes de recherches comme Solagro, l’IDDRI, le Basic, qui ont fait des scénarios et qui montrent bien qu’on peut tout à fait projeter une agriculture à 2050 sans produits chimiques de synthèse et sans engrais minéraux et nourrir, avec une assiette différente, avec moins de produits animaux qui permet d’accepter une baisse de rendements parce qu’on aurait moins de céréales à produire pour nourrir toutes ces bêtes qui sont élevées pour faire manger trop de viande. Cette agriculture biologique n’est pas du tout conçue et approchée par l’état comme une alternative qui pourrait être envisageable mais comme un marché de niche ce qui explique que ça n’ait pas pu marcher. Il n’y a pas d’aide directe. »
Le praticien vétérinaire – avril 2024, « La transition agroécologique en pratique : le scénario Afterres2050 », avec Caroline Gibert, Sylvain Doublet et Christian Couturier, « Plusieurs organisations ont conduit des travaux de prospective permettant d’envisager l’avenir de nos systèmes alimentaires. Pour le territoire français, le scénario Afterres2050 de Solagro est particulièrement abouti. Il illustre bien le changement de paradigme que représente la transition agroécologique et la nécessité d’une réflexion de transformation systémique de notre système alimentaire. »
Film Kameah Production – Mars 2024, « La théorie du boxeur », dans lequel Afterres est cité et Sébastien Blache, agriculteur du réseau OSAÉ, est interviewé.
France Télévision – Sur le Front- Mars 2024, « Enquêtes sur la terre qui nous nourrit », « Le constat est sans appel : 89 % des terres agricoles en France sont appauvries et les conséquences se ressentent sur la qualité des produits alimentaires. », avec le témoignage de Jonathan Kirchner, administrateur de Solagro
Culture Agri – Avril 2024, « Le projet Life Biodiv’Paysanne veut allier biodiversité et agriculture », « L’Occitanie s’implique dans le programme européen Life (L’Instrument Financier pour l’Environnement) au travers du projet Life Biodiv’Paysanne. Prévu pour six années, le projet a pour but la restauration des espaces naturels et la protection de la biodiversité sur les sites naturels et les espaces agricoles de la région. Lancé en 2021 jusqu’à l’horizon 2027, le projet possède de nombreux partenaires tels que Solagro, les Conservatoires d’Espaces Naturels et l’association Terres de Liens. »
Info Libertaire – fév 2024, « Agriculture : derrière les blablas macronistes, de nouveaux accords de libre échange en vue », « Il y a comme un grand retour au productivisme des années 70 », observe aussi Christian Couturier, directeur de l’association Solagro. Comme le montre le graphique de Reporterre, les élevages ne cessent de se concentrer, les tracteurs sont de plus en plus puissants pour permettre d’exploiter de plus grandes surfaces avec un minimum d’agriculteurs, les surfaces irriguées (pour augmenter les rendements notamment) croissent, l’endettement des agriculteurs aussi. (…) « Il n’y a aucune remise en cause de la trajectoire tendancielle, et elle n’est pas rose, poursuit l’ingénieur. On continue à perdre des actifs agricoles, des terres agricoles, du potentiel productif. Les nappes d’eau sont contaminées par les pesticides. C’est alarmant et hors de contrôle. » Il cite une étude de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). « Elle a évalué les coûts cachés du système alimentaire français à 163 milliards d’euros par an, et encore elle n’inclut pas les pesticides. C’est sous-évalué et cela représente déjà 10 % du PIB »
Région Occitanie – fév 2024, « Podcast Par ici le futur! Comment se nourrir demain? – Episode 1 », « Lancé à l’occasion du début du Salon International de l’Agriculture 2024, le premier épisode consacré à l’agriculture est d’ores et déjà disponible, avec comme invités : François Purseigle, auteur du livre ‘Une agriculture sans agriculteur’, Julien Nowak, jeune vigneron installé à Vauvert dans le Gard, Nicolas Métayer, directeur adjoint de l’association Solagro basée à Toulouse qui accompagne les agriculteurs dans l’agro-écologie et Marie Corbel, directrice technique du conseil interprofessionnel des vins du Languedoc. »
Perspectives agricoles – fév 2024, « Projet BAG’AGES : impact des pratiques agroécologiques sur les performances », « Les exploitations en ACS qui mettent en œuvre les principes les plus avancés de l’agroécologie voient leurs niveaux de charges totales peu évoluer. Mais leurs performances technico-économiques et environnementales sont modifiées. » avec Sylvain Doublet
Reporterre – Février 2024, « Toujours plus industrielle, l’agriculture française s’enferme dans l’impasse », « Il y a comme un grand retour au productivisme des années 70 », observe aussi Christian Couturier, directeur de l’association Solagro. Comme le montre le graphique de Reporterre, les élevages ne cessent de se concentrer, les tracteurs sont de plus en plus puissants pour permettre d’exploiter de plus grandes surfaces avec un minimum d’agriculteurs, les surfaces irriguées (pour augmenter les rendements notamment) croissent, l’endettement des agriculteurs aussi. » […]
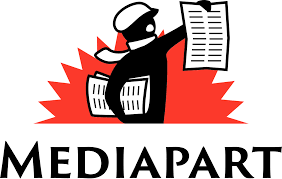
Mediapart – Mai 2024, « Loi d’orientation agricole, le rendez-vous manqué de la planification écologique », « Adossée à un travail prospectif, la planification doit se traduire en acte et reposer sur un processus démocratique, permettant de mobiliser les citoyens et les acteurs du territoire afin de faire évoluer les pratiques de production, de distribution et de consommation. Les collectivités tentent bien d’orchestrer cette planification écologique, en s’adossant à des scénarios comme Afterres2050 et en engageant des politiques pour favoriser l’installation sur des productions en agriculture biologique. En travaillant également auprès des réseaux CIVAM (Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural) pour favoriser la reprise de ferme et la mobilisation des futurs cédants, un enjeu crucial, comme l’évoque la journaliste Amélie Poinssot dans son ouvrage sur le renouveau paysan. Mais un enjeu qui ne fait pourtant l’objet d’aucunes politiques nationales d’envergure. » […]
Agrapresse – Mai 2024, « Modéliser le futur des surfaces cultivées, un casse-tête », « Au-delà des rendements, comment évolueront les surfaces cultivées ? La question est difficile pour les chercheurs. « Nous savons à peu près où se situent les grandes ressources de SAU dans le monde qui permettraient de produire des céréales », explique Sylvain Doublet, responsable agronomie et climat et Solagro. « Vous avez le Brésil où il y a une ressource incroyable, mais par contre il faut détruire la forêt. Et puis après, il y a toute la zone Russie-Ukraine où il y a des réserves de terres sous-exploitées, selon les codes de l’agro-industrie, qui vont être de plus en plus accessibles et fertiles grâce au changement climatique ». » […]
Podcast Vlan! – Mai 2024, « Podcast #304 Comprendre et lutter contre les nouvelles maladies de notre civilisation avec Jean-David Zeitoun », Solagro et Afterres cités à 55 min, « Il faut repenser l’offre, de A la semence, à Z » ça a été planifié par […]Solagro qui a fait un plan : Afterres2050 avec un programme pour que ça se fasse pour la France. On reste en autonomie, avec une agriculture moins émissive et on change l’alimentation, mais on arrive à quelque chose de faisable, plus compatible avec les objectifs que théoriquement on a tous. C’est possible. » […]
Cdurable! – Mai 2024, « Concilier transition agricole et alimentaire, c’est possible ! »,« Afterres2050 est le premier scénario pour la France qui vise une transition écologique conciliant les différents enjeux » […]
Podcast Biocoop – Murmurations – Juin 2014, « 2040, nouvelles fermes, nouveaux champs…des possibles », « 1# Cet épisode de Murmurations nous embarque vers la ferme du futur de Philippe Pointereau, un agronome investi dans les modélisations Afterres, scenario prospectif sur l’agriculture, l’alimentation et l’énergie. Nous découvrons un lieu de vie, collectif de savoir-faire, attrayant, garant de sols vivants. Une agriculture libérée du poids de la chimie, qui réinvestit dans les semences, réconciliée avec le paysage et les paysans. » […]

Sciences et avenir – Juin 2024, « Dans une France à +4°C, l’agriculture va devoir se réformer en profondeur », « […] après avoir augmenté en moyenne de 1,2 quintal par hectare et par an entre 1955 et 1996, le blé ne progresse plus. Selon les études menées par l’INRAE, les variations climatiques seraient la cause directe de 30 à 70% de cette stagnation, la part restante provenant de l’abandon de cultures de légumineuses qui enrichissaient les sols et de la diminution des épandages d’engrais chimiques. « Pour l’agriculture actuelle, dont le principal objectif est de produire beaucoup pour compenser les prix faibles, c’est une très mauvaise nouvelle », prévient Sylvain Doublet, agronome à l’association d’ingénierie et de conseil Solagro. » […]
Réussir – Juin 2024, « Méditerranée : en quoi consiste le projet de reconquête de la santé des sols qui vient d’être lancé ? », « Il a pour nom GOV4ALL et il vient d’être lancé par différents acteurs dont Solagro. L’objectif de ce projet recherche ? Favoriser le changement de pratiques agricoles pour reconquérir la santé des sols avec une cohésion territoriale » […]
Géo – Août 2024, « Méditerranée, un nouveau jardin tropical », « Tempêtes, grêle, gelées tardives, inondations… Plus que la hausse des températures, c’est l’intensité de ces aléas qui caractérisera le climat de demain. « Nous sommes entrés dans l’ère du dérèglement climatique, explique Sylvain Doublet. Autrefois, on avait des climats tropicaux ou tempérés, et il était simple de définir une année climatique moyenne. Aujourd’hui, l’année moyenne devient exceptionnelle. » Dans ces conditions, difficile d’imaginer transformer l’Europe méditerranéenne en un grand jardin tropical. Les agroclimatologues ont en tout cas cessé de voir dans les cultures exotiques une opportunité à grande échelle. » […]
Reporterre – Nov. 2024, « Pourquoi les agriculteurs se remobilisent », « « On observe aussi une forte disparité des revenus en fonction des filières, de ce qu’on appelle les orientations technico-économiques de l’exploitation, de la taille de la ferme et de la région », observe Christian Couturier, directeur de l’association Solagro. Entre 2017 et 2022, un éleveur de bovins allaitants gagnait presque trois fois moins qu’un agriculteur en grandes cultures — 20 000 euros par an en moyenne pour le premier, contre 55 000 euros pour le second. Enfin, ces revenus sont soumis à de fortes fluctuations liées aux conditions météorologiques et aux marchés mondiaux. »
Terre Dauphinoise – Nov.2024, « Entre attentes et réalités, l’agriculture iséroise face à un tournant », « En présentant la vision prospective du système agricole et alimentaire du territoire du PAIT à l’horizon 2050, Eloïse Descamps, en charge de ce travail, a indiqué que « l’ambition du territoire était de construire un scénario qui contribue à la transition écologique, répond aux besoins de la population, permet de conserver le dynamisme du secteur agricole et fédère et mobilise l’ensemble de ses acteurs ». Les questions de la santé et de l’empreinte carbone des habitants ont été identifiées comme des enjeux incontournables. »
News Days – Nov. 2024, « Il y a plus de 50 ans, le remembrement a transformé le paysage breton : un progrès à quel prix ? », « Il a fallu avancer car la haie était considérée comme un obstacle », rappelle l’agronome Philippe Pointereau. Cependant, nous savons désormais qu’il répond à toutes les attentes lorsqu’il s’agit de lutter contre le changement climatique. » Ainsi, au cours des deux premières décennies, le remembrement des terres ne répondait qu’à des besoins de surface. « Nous avons créé des parcelles vers la pente pendant que le bocage ralentissait l’eau, sans jamais imaginer les risques d’érosion et de ruissellement », explique Philippe Merot, ancien directeur de recherche à l’INRA. Parallèlement à l’évolution des pratiques agricoles, la disparition des digues continue de favoriser la pollution (pesticides, azote, etc.), malgré l’amélioration des pratiques agricoles, et impacte la biodiversité. »
Innovations Agronomiques – 2024, « Vers l’émergence de stratégies territoriales pour renforcer les régulations biologiques : une approche trans- disciplinaire. », 2024, 96, pp.88–99. 10.17180/ciag-2024-vol96-art07. hal- 04728255 – Sandrine Petit, Audrey Alignier, Roland Allart, Stéphanie Aviron, Hugues Boussard, Pierre FRANCK, Caroline GIBERT, Sylvie LADET, Claire LAVIGNE, Lou LECUYER, Lucile MUNERET, Sylvain POGGI8, Benoit RICCI, Adrien RUSCH, Aude VIALATTE, Juliette YOUNG.
– PESTICIDES –
L’Yonne Républicaine – Avril 2024, « Commune par commune, où utilise-t-on le plus de pesticides dans l’Yonne ? », « L’Yonne n’est pas le département français où l’agriculture utilise le plus de pesticides. Mais certains secteurs, en premier lieu les zones viticoles et le nord-ouest du département, sont les plus touchés. Découvrez la situation de votre commune grâce à cette carte interactive. », « Solagro est une entreprise associative et un cabinet d’experts de l’agroécologie dont l’objectif principal est de favoriser des pratiques plus durables dans l’agriculture, la forêt et l’environnement. La carte ci-dessous a été réalisée à partir de données nationales qu’elle a collectées. »
Le Journal du Centre – Avril 2024, « Pesticides dans la Nièvre : quelle est la situation dans votre commune ? », « La Nièvre n’est pas le département français où l’agriculture utilise le plus de pesticides, loin de là. Mais certains secteurs, les zones viticoles et le nord-ouest notamment, sont touchés. Et des agriculteurs commencent à demander réparation. Solagro est une association qui vise à favoriser des pratiques plus durables dans l’agriculture, la forêt et l’environnement. La carte ci-dessous a été réalisée à partir de données nationales qu’elle a collectées. »
Le phare de Ré – Mars 24, « Si on veut rassurer, autant être transparent », « Un véritable détonateur. Bien sûr, depuis quelques années déjà, les pesticides sont une préoccupation, au niveau national comme local avec le cas de la plaine d’Aunis. Mais sur l’île de Ré, c’est la carte publiée en 2022 par Solagro qui a fait bouger des choses. »
Rue89 Strasbourg – fév 2024, « Près de 30 communes alsaciennes fortement exposées aux pesticides »,« L’Alsace compte 27 communes où, tous les ans, plus de cinq traitements phytosanitaires par hectare de culture sont utilisés, selon des estimations de l’association Solagro. Parallèlement, des études commencent à montrer une probable augmentation du risque de maladies chez les riverains des zones agricoles. », d’après l’interview d’Aurélien Chayre
Le Monde – Mai 2024, « 300 contaminants dans nos nappes : polluant par polluant, notre analyse des eaux souterraines en France » et « Comment « Le Monde » a cartographié la pollution des eaux souterraines » renvoyant vers la carte Adonis des pesticides.
Maison & Travaux – août 2024, « Voici comment savoir quels pesticides ont été pulvérisés près de chez vous (et à quelle dose) », « Comme le révèle l’association Solagro, « dans les zones agricoles spécialisées, grand bassin parisien, vallée de la Garonne, couloir rhodanien, Limagne, territoires viticoles et arboricoles, que ce soit en viticulture, en arboriculture fruitière ou en grandes cultures, on observe une pression phytosanitaire élevée du fait d’un assolement peu diversifié et de pratiques agricoles plus intensives ». »
Média24 – Juillet 2024, « Les pesticides sont très présents dans ces communes de France ! Quel impact sur votre santé ? », « Le projet Adonis, développé par Solagro, a permis de cartographier et d’évaluer l’usage des pesticides à l’échelle communale, offrant ainsi une perspective détaillée sur la distribution et l’intensité de cet usage sur le territoire national. » […]
Pleine Vie – Juillet 2024, « Pesticides dans les fruits et légumes : voici les régions françaises les plus contaminées selon une étude (la vôtre en fait-elle partie ?) », » En 2023, l’association Solagro a révélé le nom des régions françaises les plus touchées par les pesticides. » […]
60 millions de consommateurs – Septembre 2024, « Agriculture : où trouve-t-on le plus de pesticides? », « Malgré les plans Écophyto successifs depuis 2008, la France conserve un gros appétit pour les pesticides. Rien, ou presque, ne bouge en la matière. « Globalement, en 2020, on était au même niveau qu’en 2010, souligne Mathilde Boitias, directrice du think tank La Fabrique Écologique, qui a publié en 2023 un Atlas des pesticides. La réduction drastique de l’usage des pesticides est loin d’être atteinte. » […]
Centre presse Aveyron – Septembre 2024, « CARTE. La commune la plus bio de l’Aveyron est juste à côté de celle qui utilise le plus de pesticides… Et la vôtre ? », « Pour chaque commune, l’association a relevé cet Indice, ainsi que la surface agricole utile (SAU), sa part par rapport à la surface de la commune, la culture principale de la commune et la culture pour laquelle les pesticides sont utilisés. On apprend ainsi que pour Rodez, cet indice est de 0,32 (vert), que la surface agricole utile est tout de même de 164 hectares (en baisse), soit 15% du territoire, essentiellement composée de prairies, et que la culture pour laquelle les produits phytosanitaires sont utilisés concerne l’orge d’hiver, une plante fourragère, mais qui sert aussi à faire… de la bière. » […]
Le Journal de Mayotte – Nov. 2024, « Avec la carte Adonis, découvrez le taux d’utilisation de pesticides dans votre commune », « Visualiser d’un clic l’intensité de pesticides utilisés dans chaque commune de France, c’est l’idée géniale de la carte « Adonis » créée par l’association Solagro. En vigueur dans l’Hexagone depuis 2022, elle s’étend désormais aux départements d’Outre-mer. »
Actu-environnement – Nov 2024, « Pesticides : Solagro actualise sa carte de France et l’étend à l’Outre-mer », « « Les systèmes agricoles dominants agroforestiers et vivriers de Mayotte et de Guyane permettent à ces deux départements d’enregistrer un usage réduit des pesticides », note Solagro. »
France Info – Nov 2024, « Adonis : une carte interactive des pesticides en France et, désormais, en Outre-mer », « Adonis, carte de France des pesticides, plaît. Cette connaissance majeure est désormais disponible pour tous et, en particulier, à destination des scientifiques et des responsables politiques nationales et européennes. »
Géoconscience – oct. 2024, « Printemps silencieux. Un pesticide est une substance utilisée pour détruire les organismes dits nuisibles. La France est un des pays du monde les plus dépendants de l’agriculture chimique », “[…]face aux enjeux environnementaux et de santé publique, il devient nécessaire d’inventer une agriculture durable économe en engrais chimiques et respectueuse des milieux. Pourquoi? D’abord pour préserver la biodiversité, ensuite pour assurer aux Français une alimentation de qualité et enfin pour réduire la prévalence des maladies chroniques. Cette carte dite “Adonis” publiée par Solagroprésente les indices de fréquences de traitement en pesticides, des résultats terribles. Elle a pour ambition de porter à la connaissance de tous, commune par commune, les quantités moyennes de ces substances chimiques utilisées [en agriculture]”. […]
News Tank Agro – déc 2024, « Carte Adonis : « L’IFT est un indicateur cohérent, au contraire de HRI1 » (Aurélien Chayre, Solagro) », « Nous avons opté pour l’IFT, car il émane d’un important travail d’enquête sur les pratiques culturales réalisé par les services de l’État, (ministère de l’Agriculture), qui produit des statistiques sur les IFT moyens par culture, faisant partie des indicateurs du plan Écophyto. L’approche « IFT territorial » d’Adonis est comparable à l’indicateur NODU. Ce qui les différencie, c’est d’abord la source des données (données statistiques pour les IFT et données de ventes de produits pour le NODU), mais aussi les doses de référence utilisées dans le calcul et le fait qu’on a l’IFT par culture, ce qui n’est pas le cas pour le NODU. L’IFT est un indicateur qui parle aux agriculteurs, or notre objectif est de produire des références mises à disposition des agriculteurs, des collectivités ou des chercheurs de manière à accélérer la transition vers des pratiques agroécologiques et biologiques. C’est un indicateur cohérent, au contraire du HRI1. » […]
Maison & Travaux – déc. 2024, « C’est dans ce département de France que le nombre de pesticides a le plus explosé, et c’est très inquiétant« , « Spécialiste des transitions climatique, agroécologique, énergétique et alimentaire, l’association Solagro tire la sonnette d’alarme. À travers la nouvelle carte Adonis des pesticides, la structure a mesuré l’évolution de l’indice de fréquence de traitement (IFT) entre 2020 et 2022. Et celui-ci a légèrement augmenté, la moyenne par commune en France étant passée de 2,36 à 2,37. Rappelons que l’indice IFT mesure, sur un territoire donné, l’utilisation des herbicides, insecticides, fongicides et traitements de semences par hectare au cours d’une campagne culturale. Et au petit jeu des augmentations d’utilisation des pesticides, c’est l’Indre qui s’en tire le plus mal. En regardant la carte, on constate qu’une large portion des communes du département ont augmenté leur IFT de plus de 20 %. Un constat qui ne peut qu’alarmer, alors qu’un département comme la Lozère fait office de bon élève. La nature des cultures et du terrain joue évidemment un rôle dans ces disparités. » […]
France 3 – déc. 2024, « Cartes. L’utilisation de pesticides augmente globalement : quelle est la situation près de chez vous? », « L’association Solagro a publié, en novembre 2024, une carte mesurant l’évolution de l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire français entre 2020 et 2022. Elle révèle une augmentation globale de leur usage sur le territoire, et la Normandie est loin d’être épargnée. » […]
– ÉNERGIE –
Alternatives Économiques – Janv.2024, « Planification écologique : l’heure de vérité pour le gouvernement »,« Ce plan minore les leviers de la sobriété et del’efficacité, et mise massivement sur la substitution des énergies fossiles par des sources décarbonées, principalement via l’électrification. Sauf qu’on risque dene pas atteindre les objectifs de substitution d’énergie pour 2030 », analyse Christian Couturier, directeur del’association Solagro. »
![]()
Actu Environnement – fév 2024, « Hydrogène vert : La molécule indispensable pour décarboner l’industrie ? »,« À la vue des investissements prévus, 2024 sera peut-être l’année de l’hydrogène « vert » en France. Négawatt et Solagro alertent néanmoins sur l’importance de donner la priorité pour son utilisation à la décarbonation de l’industrie. », « En ayant notamment recours à une meilleure rotation des cultures intégrant des légumineuses plus à même de capter l’azote de l’air, et en valorisant davantage les engrais de ferme issus de la méthanisation, l’économie pourrait s’affranchir d’une grande part d’engrais azotés – au moins la moitié – et donc d’ammoniac », résume Simon Métivier, en se référant au scénario Afterres2050 de Solagro (conduit sur la base du scénario de négaWatt).
Gaz d’Aujourd’hui – Juin 2024 – Biomasse : vecteur de transition – : « Prélèvement de la bioénergie : à la recherche du bon équilibre », « Dans une perspective de développement des bioénergies pour satisfaire les objectifs de transition, la question du niveau « raisonnable » de prélèvement de biomasses est cruciale. En dehors des biomasses agricoles nécessaires à la production de biogaz, le besoin de ressources forestières concentre les plus fortes interrogations. Ces trois dernières années, plusieurs analyses ont été produites à ce sujet, notamment dans les scénarios de l’Ademe et de Solagro avec l’Association négaWatt, ainsi que par France Stratégie, la Fabrique écologique et plus récemment Carbone 4 pour France Bois Forêt. » […]
Gaz d’Aujourd’hui– Juin 2024 – Biomasse : vecteur de transition – « Gaz renouvelables : les voies de la durabilité », « Si les acteurs de la filière des gaz renouvelables reconnaissent qu’une gestion équilibrée de la biomasse sera indispensable, ils estiment néanmoins que le sujet de la biomasse est trop souvent utilisé par les opposants pour freiner leur développement. Or, selon une analyse menée par France gaz renouvelables compilant plusieurs études et scénarios, réalisés sur le sujet par Solagro, l’Ademe, FranceAgriMer ou encore négaWatt, la France pourrait s’appuyer sur une trajectoire de production de méthane renouvelable et bas carbone réaliste, comprenez en y intégrant d’éventuelles compétitions d’usage de 320 TWh en 2050, soit la consommation nationale de gaz estimée à cet horizon, en donnant des objectifs ambitieux à l’ensemble des filières de production, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui dans la stratégie française pour l’énergie et le climat (SFEC) puisque seul le potentiel de la méthanisation a été retenu à ce stade par l’administration. » […]
![]()
Usine nouvelle – Octobre 2024, « La France n’a pas assez de biomasse locale pour sortir des fossiles et atteindre la neutralité carbone en 2050 « , « Alors que la France importe déjà la moitié de la biomasse nécessaire à la production de biocarburants, les besoins vont croître de 30 à 50% d’ici à 2030 et quasiment doubler d’ici à 2050. Or, on doit passer des biocarburants de première génération, à base de cultures dédiées, à des biocarburants avancés, à base de résidus. « Personne ne sait comment remplacer les 20 TWh que l’on importe déjà, ni comment produire 20 TWh supplémentaires », observe Christian Couturier, le directeur de l’association Solagro. » […]
Réussir – Octobre 2024 – « Biogaz : quelle biomasse additionnelle accessible à la méthanisation en cas de décapitalisation ? », « Dans le rapport « Étude de nouveaux gisements de biomasse végétale fermentescible, et des conditions » commandé par France Agrimer à Solagro, apparaît une première estimation de la biomasse additionnelle rendue disponible à la méthanisation en cas de décapitalisation. » […]
News Tank Agro – Octobre 2024, « Biomasses : « Toutes les filières ne sont pas matures » (S. Métivier et S. Berger, Solagro) », « Il existe des filières de biomasses matures et non matures « , déclare Simon Métivier, chargé de projets bioénergies à Solagro et co-auteur du rapport « Quelles biomasses pour la transition énergétique? » […]
La France Agricole – Octobre 2024, « L’agriculture française représentera 60% de la biomasse énergétique en 2050 », « Dans son rapport « Quelles biomasses pour la transition énergétique ? », le cabinet Solagro tente d’éclairer le débat sur le potentiel de biomasse mobilisable en France à l’horizon de 2050. Il souligne le rôle clé de l’agriculture et de la méthanisation. » […]
Réussir – Octobre 2024, « Biomasse et transition énergétique : que dit le dernier rapport de Solagro ? », « Dans son rapport, Solagro confirme ses estimations précédentes d’un potentiel de l’ordre de 340 TWh de bioénergies pour la France, dont 160 TWh de biométhane. » […]
GreenUnivers – Octobre 2024, « La valorisation de la biomasse passée au crible », « La ressource en biomasse existe. Alors que le débat sur sa disponibilité à moyen terme est monté en puissance au cours des derniers mois, Solagro vient l’étayer » […]
Carac’Terres – Octobre 2024, « Le rôle stratégique de l’agriculture dans l’énergie de demain« , « Dans les prévisions de production de biomasse en 2050, l’agriculture assurerait plus de la moitié des apports. Mais à l’heure actuelle, à part via la méthanisation, les filières de valorisation ne sont pas suffisamment développées pour assurer ces ambitions. » « Au centre de la contribution de l’agriculture à la production d’énergie, il y a avant tout un équilibre à trouver : produire le plus d’énergie possible sans pour autant délaisser la production alimentaire et le maintien de l’azote au sol, qui restent prioritaires. Les bioénergies, qu’il s’agisse de biomasse solide, liquide ou gazeuse, vont être davantage mises à contribution pour atteindre l’objectif de 20 % du mix énergétique français à l’horizon 2050. D’un potentiel de 40Mt de matière sèche pour la production de chaleur (bois, carburant, biogaz), il faudrait arriver à 100Mt. L’entreprise associative Solagro a mené une enquête pour identifier ce potentiel et évaluer les filières de valorisation en France. Et l’agriculture y tient un rôle central, avec un potentiel de 58 Mt sur les 100 espérés ». […]
Référence Agro – Nov. 2024, « Fabacéé, 17 M€ pour soutenir la transition énergétique agricole », « Intégrer une dynamique d’accompagnement pour réduire les consommations énergétiques, telle est l’ambition du programme Fabacéé s’ouvre pour sa première promotion avec un appel à candidatures allant jusqu’au 15 novembre. Il est doté d’un budget de 17 millions d’euros pour des actions sur trois ans, de 2025 à 2027. »
Alternatives économiques – Septembre 2024, « Comment sevrer l’agriculture de sa dépendance au pétrole et au gaz », « Le scénario de transition Afterres2050 élaboré par l’association Solagro a chiffré le potentiel de toutes ces économies d’énergie » […]
AgriTV – Octobre 2024, « Peut-on faire encore des économies sur sa ferme? », interview de Romain Behaghel pour le programme Fabacéé
Actu Environnement – Oct. 2024, « Un outil pour concilier transition énergétique et paysages », « Avec son outil « Étape paysage », le Collectif Paysages de l’après-pétrole propose de se reposer sur la démarche paysagère pour spatialiser les ambitions énergétiques des territoires. L’idée est d’engager une réflexion collective sur la localisation des installations d’énergies renouvelables et des actions de maîtrise de l’énergie tout en s’interrogeant sur les paysages créés. L’outil s’appuie sur les particularités des paysages du territoire concerné et sur ses données énergétiques, issues des scénarios prospectifs de négaWatt et de Solagro. Il est aussi développé en collaboration avec le dispositif Destination Tepos, porté par le Cler – réseau pour la transition énergétique. »
Alternatives Économiques – déc 2024, « Une agriculture à énergie positive, c’est possible », « Le scénario de transition Afterres2050, élaboré par l’association Solagro a chiffré le potentiel de toutes ces économies d’énergie. Elles pourraient totaliser jusqu’à 4 Mtep à l’horizon 2050. » […]
Les Clés de la Transition énergétique – déc 2024, « L’agriculture représentera 60 % du potentiel de biomasse énergétique en 2050« , « L’objectif est d’éclairer le débat sur le potentiel et les usages de la biomasse mobilisable pour l’énergie en France à l’horizon 2050, sans concurrencer l’alimentation, le maintien de la fertilité des sols et la production de matériaux. Selon l’étude, le potentiel de ressources pour 2050 s’élève à 100 millions de tonnes de matières sèches par an (Mt MS/an), soit un maximum de 340 TWh, dont environ 60 % proviennent de l’agriculture – cultures intermédiaires à vocation énergétique, résidus de cultures, effluents d’élevage, excédents d’herbe –, 20 % du bois issu de forêts ou hors forêts, 20 % des déchets de ces filières. Ce potentiel de biomasse est mobilisable si les ressources sont valorisées pour la production d’énergie avec un retour au sol des sous-produits. « […]
Le Monde – nov 2024, « Comment décarboner l’agriculture française à l’horizon 2050 : les propositions du Shift Project », « L’association emboîte ainsi le pas à d’autres institutions qui ont auparavant travaillé sur des scénarios de prospective agricole, de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae) à l’association Solagro. » […]
Revue Sésame – déc. 2024, « Une copie (bas) carbone », à propos du rapport du Shift Project : « Les conclusions de ce rapport ont été plutôt favorablement accueillies par le monde agricole, c’est suffisamment rare pour être souligné, au cours d’un grand oral, FNSEA et Confédération paysanne en tête… Même si l’absence du volet économique et des questions de rentabilité affaiblit l’exercice, comme le souligne la presse qui salue toutefois l’approche pragmatique des travaux. Pour devenir incollable sur le sujet, on peut aussi se reporter aux travaux précurseurs de Solagro (Afterres) qui parvient peu ou prou aux mêmes conclusions au moins sur l’étroitesse de la voie selon Christian Couturier. Mais avec une divergence sur les moyens, Solagro mise majoritairement sur le bio, Shift Project sur l’agriculture de conservation, explique-t-il. » […]
– ÉLEVAGE –
La France Agricole – Juillet 2024, « Un futur « peu désirable » pour l’élevage si rien ne change », « Ce n’est pas une prédiction mais un moyen de dégager les tendances », avertit Léa Spinazzé, directrice adjointe de l’Iddri qui s’est entourée des filières concernées, l’Anvol pour les volailles de chair, Inaporc et Interbev, et de quatre autres cabinets d’expertise en environnement (Asca, Basic, I4CE et Solagro). « Nous avons voulu lancer cette étude parce que l’élevage est au cœur des enjeux sociétaux mais on en débat assez mal », ajoute Pierre-Marie Aubert, directeur du programme sur les politiques agricoles à l’Iddri. »[…]
Futuribles – déc 2024, « Des filières viande française sous tension », « Lors d’une conférence tenue en juillet 2024, l’Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI) a présenté l’étude Des filières viandes françaises sous tension : entre pressions compétitives et accès à la biomasse. Celle-ci a été réalisée en association avec AScA, Solagro et l’Institut de l’économie pour le climat (I4CE), et nourrie d’échanges avec les professionnels des filières d’élevage de volailles, de porcs et de bovins. » […]
– FORÊTS & BOIS –

Alternatives Économiques – Janv.2024, « Faut-il préserver ou davantage exploiter la forêt française? », » Entre gestion intensive et extensive, il existe par ailleurs des propositions intermédiaires, comme celle del’association Solagro, qui mise dans son scénario Afterres2050 sur une augmentation des prélèvements d’environ 20 %, mieux répartis entre les massifs. »
Le Monde de l’énergie – Janv.2024, « Le bois énergie reste un pilier de la chaleur renouvelable dans la PPE »,« Le Monde de l’Énergie ouvre ses colonnes à Florin Malafosse, responsable Forêt et filière Bois à Solagro, auteur du rapport Afterres2050 Forêt & Bois – un rôle déterminant dans la transition écologique, pour évoquer avec lui la place de la filière forêt-bois dans la stratégie climatique de la France. »
Le Journal des Énergies Renouvelables – Avril 2024, « Hors série Bois-énergie : réalité et enjeux », avec trois interviews de Florin Malafosse
Batirama – Avril 2024, « La petite entreprise du Forum FBC ne connait pas la crise », « La session d’ouverture du Forum, le jeudi 4 avril au centre Prouvé de Nancy, faisait la place belle à l’étude que la filière Forêt-Bois a commandée à Carbone 4, afin de mieux identifier les flux carbone de la transformation du bois. En contrepoint, la veille, lors des sessions inaugurales d’Epinal, une session 1 consacrée à la forêt, dans le grand amphithéâtre de l’école d’ingénieur ENSTIB, avait culminé avec les explications de Christian Couturier de Solagro quant à l’évolution des scénarios Afterres. »
Fordaq – fév 2024, « Parution du programme du 13ème forum bois-construction », « L’utilisation des bois français en France est vitale, y compris celle des bois attaqués, pour financer l’adaptation de la forêt au choc climatique. Il se trouve cependant que la forêt française est feuillue, tandis que la récolte et la transformation est résineuse. Quand on répète que cette récolte ne concerne que 60% des accrus, on oublie de ventiler par essences et si on le fait, on se rend compte que l’exploitation des résineux est au taquet. La disparition de l’épicéa est programmée en Europe, mais le volume sur pied est tel que cela demandera encore une bonne dizaine d’années, pendant lesquelles l’exploitation forcée jettera sur le marché des quantités dantesques qui écraseront de développement de bois d’œuvre feuillus notamment en construction. Et ensuite ? Ensuite, on réutilisera les charpentes en résineux, y compris les BLC qu’aujourd’hui personne ne veut assurer, parce que les filières bois se sont concentrées sur la production et pas encore sur le réemploi. On prendra une marge d’erreur mais ça passera si le BLC n’a pas été exposé aux intempéries. Ce scénario dramatique n’est pas partagé par la filière bois européenne, ou bien seulement à demi-mot. Admettons qu’il s’agisse d’une conjecture, d’un scénario noir de presse à sensation. Au Forum, les sachants seront là pour corriger, d’une part Solagro à Epinal, représenté par son fondateur Christian Couturier qui couronne la session consacrée à la ressource. Il est particulièrement important de rapprocher le travail des scénarios Afterres avec celui des élèves ingénieurs, d’autant que l’ingénierie elle-même se frugalise. »
Sciences et Avenir – Juillet 2024, « Haies : le renouveau des paysages ruraux », « Là réside le nœud du problème : les parcelles sont de plus en plus grandes et les exploitations agricoles de moins en moins nombreuses. « Depuis la révolution agricole des années 1950, les fermes se sont spécialisées, ce qui a permis de compenser la baisse des prix par des rendements accrus, explique Sylvain Doublet, ingénieur dans le cabinet spécialisé Solagro. Il a donc fallu mécaniser, et pour cela, ôter les obstacles devant les machines, en premier lieu les haies. » […]
La République des Pyrénées – déc 2024,« Le volume nécessaire existe » : Elyse Energy rassure sur les besoins en bois pour son projet », « Après une nouvelle réunion du comité de suivi, la PME se dit confortée dans sa stratégie d’approvisionnement diversifié (forêts, déchets-bois, bois agricole). Un expert mandaté par la Commission du débat public émet cependant quelques doutes. » […]
Sud-Ouest – déc 2024, « Projet E-CHO en Béarn : des « lacunes » sur les perspectives d’approvisionnement en biomasse relevées par un expert », « Mandaté par la Commission nationale du débat public (CNDP) afin d’expertiser la méthode employée par Elyse Énergie pour évaluer les ressources disponibles, le bureau d’études Solagro a fait part de ses conclusions par la voix de Florin Malafosse. « Je ne suis pas là pour donner un avis d’opportunité du projet », prévient le prestataire de la CNDP, avant de livrer ses observations. Pas de réquisitoire de sa part donc, mais le signalement de lacunes dans la méthodologie d’approvisionnement en bois (agricole, déchets et issus de forêts) avancée par Elyse Énergie et son bureau d’études MTDA. » […]
– CLIMAT –

Reporterre – janv 2024, « Cugnaux (Haute-Garonne) à + 4°C… Qu’es aquò ? table-ronde », « L’association Cugnaux en Transition organise une table ronde sur le changement climatique avec 4 invité·e·s du sujet qui mettront des mots sur ce qui se cache derrière ces « +4°C » et qui nous montreront que l’inaction n’est pas une fatalité. Avec Christian Couturier«
Novethic – Avril2024, « Comment les industriels de l’élevage tentent de minimiser leur impact climatique », « Pourtant, utilisé hors du cadre scientifique rigoureux pour lequel il a été conçu, le PRG* pose de nombreux problèmes méthodologiques. “En utilisant le PRG*, on pourrait arriver à une entourloupe : les pays pauvres qui consomment peu de viande mais ont un secteur de l’élevage en croissance auraient un PRG* très haut, alors que les pays riches, qui consomment beaucoup de viande, mais dont le cheptel n’augmente pas beaucoup, auraient un PRG* bas”, explique Christian Couturier. Un résultat absurde : les plus gros producteurs de viande contribueraient alors moins au réchauffement climatique que ceux qui n’en produisent presque pas. »
RSEdatanews – fév 2024, « Décarbonation : des incertitudes planent sur les potentialités du biométhane »,« Selon Simon Métivier, chargé de projet Gaz renouvelables pour l’association de prospective spécialisée sur les sujets dʼagro-écologie et dʼénergie Solagro, une part des divergences de prospective sur le gisement potentiel en biomasse est liée à un désaccord sur la définition dʼune production « durable » de biométhane ».
Cdurable ! – Juin 2024, « Le méthane dans les stratégies d’atténuation : un enjeu majeur », « Les émissions de gaz à effet de serre (GES) sont calculées grâce à un outil comptable, le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG), utilisé dans la plupart des travaux liés à la lutte contre le réchauffement climatique. Ce décryptage analyse les pistes d’amélioration de cet indicateur afin de mieux tenir compte des spécificités des différents GES dans leur contribution au réchauffement climatique, notamment le méthane. Ce décryptage a été rédigé par Christian de Perthuis, Professeur d’économie à l’Université Paris Dauphine-PSL, Christian Couturier, Directeur général de Solagro, et Sophie Szopa, Directrice de recherche du CEA, Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement (IPSL – Université Paris-Saclay) » […]
Mr Mondialisation – Août 2024, « L’industrie animale tente de cacher son impact climatique », « On ne peut pas additionner des choux et des carottes, avons-nous appris à l’école élémentaire. De même, on ne peut pas additionner les tonnes de CO2 et les tonnes de méthane (CH4), les deux principaux gaz à effet de serre rejetés par l’activité humaine », explique Christian Couturier, directeur à Solagro, association de recherche sur les enjeux écologiques dans l’agriculture et co-auteur d’un article sur le sujet. « Si on veut mesurer leurs contributions respectives au réchauffement global, on doit les convertir dans une unité commune ». […]
![]()
Le Monde – Octobre 2024, « 2024, une année de calamités pour l’agriculture, durement frappée par le dérèglement climatique », » « Ces effets d’à-coups dans la production sont un signal fort des impacts du changement climatique, observe Nicolas Métayer, directeur adjoint de l’association de prospective agricole Solagro. La crise climatique n’est pas un horizon lointain, c’est déjà une réalité, et ça n’est que le début des changements. » S’ils ont toujours été confrontés aux aléas climatiques, les agriculteurs font désormais face à des phénomènes météorologiques à la fréquence et à l’intensité accrues. » […]
La France Agricole – Nov 2024, « Un outil actualisé pour projeter son exploitation dans le climat futur », « Climadiag Agriculture mobilise un nouveau jeu de données pour ses projections, et tourne avec dix-sept modélisations climatiques, contre une dizaine auparavant. « L’outil s’inscrit désormais pleinement dans la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique (Tracc), qui fixe un horizon commun aux politiques d’adaptation », explique Sophie Martinoni-Lapierre, directrice de la climatologie et des services climatiques de Météo-France. Et Nicolas Métayer insiste : « Nous maintenons la performance de l’outil, avec un temps d’attente des résultats limité à 3–5 secondes. » Climadiag Agriculture a été conçu pour être un outil au service des conseillers agricoles, mais il peut également être utilisé par les agriculteurs eux-mêmes. Des indications aident la lecture des graphiques. »
Terre-net – Octobre. 2024, « Rémunération carbone : le bio veut sa part du gâteau », « Les projets de compensation carbone deviennent réalité. Ils contribuent à financer la transition des exploitations agricoles. En complément des labels existants, la Fnab développe son propre outil pour tenir compte des spécificités des systèmes bio et enrichir les méthodes d’évaluation. » […], avec l’outil ACCT FNAB développé par Solagro
Agence France Presse – déc 2024, « Météo France enrichit son outil aidant les agriculteurs à s’adapter au changement climatique », « Climadiag Agriculture s’appuie sur la TRACC, une trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique retenue par le gouvernement. « On part de l’hypothèse qu’il faut se préparer à un réchauffement de 2 degrés en 2050 et de 3 degrés en 2100 au niveau mondial », précise Sophie Martinoni. […] « Le portail commence à être bien repéré auprès de nos cibles: les conseillers agricoles », se réjouit Nicolas Métayer, directeur adjoint de l’association Solagro. « Cela leur permet de mieux comprendre les enjeux climatiques et d’imaginer ce qu’ils peuvent mettre en place pour s’adapter. » » […]
Ouest France – déc. 2024, « Climat et agriculture : une appli de Météo France pour s’adapter au réchauffement », « Développée avec l’association Solagro et l’Inrae (Institut national de recherche pour l’agriculture et l’environnement), l’outil numérique permet de mesurer l’impact du changement climatique sur les cultures mais aussi les animaux (porc, volaille, bovins) de manière très précise. « Le maillage géographique compte 10 000 points de 8 km sur 8 km, avec 250 indicateurs prêts à l’emploi, précise Nicolas Métayer, directeur adjoint de Solagro. L’objectif est d’aider le monde agricole à mettre en place des stratégies pour s’adapter à long terme, alors qu’en agriculture on raisonne souvent à très court terme. » » […]
Plein Champ – déc. 2024, « Climadiag Agriculture, un simulateur des impacts climatiques à l’échelle de l’exploitation », « Météo-France et l’association Solagro ont développé un outil en ligne permettant de mesurer les impacts du changement climatique aux horizons 2030, 2050 et 2100, agrégeant plus de 230 indicateurs spécifiques des filières végétales et animales, sur une maille de 8km par 8km. » […]
Terre-net – déc. 2024, « Météo-France enrichit son outil Climadiag Agriculture », « « Le portail commence à être bien repéré auprès de nos cibles : les conseillers agricoles », se réjouit Nicolas Métayer, directeur adjoint de l’association Solagro. « Cela leur permet de mieux comprendre les enjeux climatiques et d’imaginer ce qu’ils peuvent mettre en place pour s’adapter. » L’outil compte actuellement plus de 4 000 utilisateurs, parmi lesquels des coopératives, des bureaux d’étude, des centres de gestion. » […]
Réussir – déc. 2024, « Météo France et Solagro proposent un service gratuit aux agriculteurs pour s’adapter au changement climatique »
Agri Mutuel – déc. 2024, « Météo-France enrichit son outil Climadiag Agriculture »
Actu.fr – déc. 2024, « Face au changement climatique, Météo-France lance un nouvel outil au service des agriculteurs », « Partenaire de l’entreprise associative Solagro, Météo-France fournit depuis quatre ans un service climatique sur mesure baptisé Climadiag Agriculture. » […]
– MÉTHANISATION –
Newsday – Janv.2024, « Comment la Vallée de Chevreuse transforme les biodéchets en énergie « , « Selon une étude réalisée en 2018 par l’association Solagro, GRDF et l’Agence de la transition écologique (ADEME), un ménage produit, chaque année, près de 83 kilos debiodéchets : épluchures de fruits et légumes, restes deyaourts, déchets de jardin… «
Agra Presse – Mars 2024, « Prairies permanentes : l’alternative biogaz », « Pour l’instant, l’usage de l’herbe en biogaz bénéficie d’un cadre souple. Le plafond de 15 % imposé aux cultures alimentaires ne concerne que les prairies temporaires : pas de limite pour les prairies permanentes. D’un point de vue technique, une unité pourrait gérer 100 % d’herbe « si elle était bien broyée », mais ce ne serait pas rentable, explique Jérémie Priarollo. »
France Bleu Occitanie – mars 2024, « La région Occitanie à la traîne sur le développement de la méthanisation agricole« , « Sur les 250 projets en région Occitanie depuis près de 15 ans, un cinquième seulement a vu le jour, le reste étant abandonné face aux contestations ou faute de financements. « Un méthaniseur c’est un projet complexe dans la mesure où on touche au vivant, à la biologie, on touche à la technique, ce sont des projets assez financiers, on touche également à la logistique, au transport et on parle aussi d’une installation qui va être gourmande en main d’oeuvre », souligne Jérémie Priarollo. La Haute Garonne ne compte que 2 méthaniseurs agricoles en fonctionnement début 2024. »
Actu Environnement – Juin 2024, « Salon Expobiogaz 2024 : deux entreprises lauréates du Trophée de l’innovation », « Le salon Expobiogaz, qui s’est tenu à Strasbourg les 5 et 6 juin 2024, a été l’occasion de récompenser les innovations dans le secteur de la méthanisation. […] Dans la catégorie Services, c’est la société Methagora qui a fait sensation au sein du jury composé de représentants de l’Ademe, GRDF, ATEE, France Gaz, Solagro ou encore l’AAMF. Methagora propose un nouveau modèle de production et de valorisation du gaz vert en optimisant les sites de méthanisation agricole existants. » […]
Perspectives agricoles – Septembre 2024, « Cive et méthanisation – des bénéfices agronomiques en cascade », « La méthanisation a également des bénéfices plus indirects sur les systèmes agricoles. Le cadre réglementaire strict est une contrainte que de nombreux agriculteurs méthaniseurs transforment en atour : « En imposant un plan d’épandage et le recours à un pendillard avec enfouisseur pour épandre les phases liquides, les pertes par volatilisation ammoniacale sont considérablement réduites, alors qu’elles sont fréquemment de 30 à 80% pour un épandage de lisier classique. Les apports azotés sont mieux valorisés », explique Jérémie Priarollo. » […]
Réussir -Octobre 2024, « Méthanisation agricole en cogénération : quelles solutions en fin de tarifs ?« , « Les premiers méthaniseurs agricoles fonctionnant en cogénération arrivent bientôt en fin de leurs contrats d’achat d’électricité. Il est temps d’anticiper l’évolution nécessaire des installations et de voir quelle solution sera la plus rentable. » […]
Cultivar – Nov. 2024, « Épandre les digestats à bon escient », « Des Cive oui, mais pas trop productives. Céline Laboubée identifie le même besoin de ne pas atteindre les extrêmes en ce qui concerne la production des Cive pour rester dans un système vertueux pour l’environnement. « Afin d’éviter des dérapages d’une conduite intensive des Cive, chez Solagro, nous misons sur un rendement compris entre 6 et 8 tMS/ha, selon le contexte pédoclimatique et la place dans la rotation, pour le dimensionnement des unités de méthanisation. Au-delà, l’itinéraire de la Cive risque d’être trop intensif et la date de récolte trop tardive, pour ne pas influencer le rendement de la culture alimentaire suivante. » Les Cive contribuent aussi à alimenter le sol en carbone organique et donc à limiter, voire éviter l’érosion constatée par l’apport de digestat. »
![]()
La Dépêche du Midi – Octobre 2024, « Il n’y a pas de concurrence entre l’alimentaire et l’énergétique », le méthaniseur de Momères produit du biogaz à partir de déchets agricoles », « L’installation de production de biogaz de Momères, BioMéthadour, en service depuis trois ans, produit 30 % de plus qu’initialement prévu. Une bonne surprise pour les exploitants des quatre fermes du village qui ont fait de leur méthaniseur un véritable projet de développement local. Avec les deux autres méthaniseurs de Trie-sur-Baïse et de Saint-Sever de Rustan, ils couvrent une partie de la consommation de gaz de ville de l’agglomération Tarbes-Lourdes. » […]
News Tank Agro – Octobre 2024, « Démarche Biométhadour : un bilan positif et une dynamique renforcée après 3 ans d’activité (Solagro) », « Un des effets indirects de la méthanisation sur nos élevages, c’est l’amélioration du confort des animaux dans les bâtiments, grâce à une augmentation des quantités de pailles utilisées » […]
Obser’ER – 2024, « 3 questions de l’Observatoire des énergies renouvelables à Thomas Filiatre, chef de projet méthanisation à Solagro et vice-président du Club Biogaz à l’ATEE énergétique de la biomasse », « La majorité des unités de méthanisation en cogénération connaissent, depuis quelques années, des difficultés économiques qui s’expliquent notamment par la crise énergétique et, en particulier, par l’augmentation du coût d’approvisionnement en électricité des unités. » […]
GRDF – déc 2024, « Prairies permanentes et méthanisation : une opportunité complémentaire à l’élevage« , « Le projet MéthaLAE, porté par Solagro, illustre de manière concrète la manière dont la méthanisation peut être intégrée dans les systèmes agricoles tout en préservant les prairies permanentes. Ce projet explore une voie innovante pour utiliser des ressources souvent sous-valorisées dans des démarches agroécologiques globales. « […]
– AGRIVOLTAÏSME –
La maison écologique – Septembre 2024, « Électrons agrivoltaïques : le vert dans la pomme? », « Il faut mobiliser dès aujourd’hui toutes les toitures domestiques et industrielles, les parkings et les friches anthropisées, comme c’est prévu dans le cade des scénarios négaWatt et Afterres2050 dans lesquels s’inscrit Solagro. Mais les toitures ne peuvent pas toujours supporter des panneaux. Ces derniers peuvent également être interdits pour des questions de sécurité incendie. Certaines friches accueillent plus de biodiversité que des terres cultivées alors que les installations agrivoltaïques peuvent rendre différents services pour améliorer la production agricole en atténuant ls effets du dérèglement climatique », explique Jean-Luc Bochu, qui insiste sur le fait que par le passé, et encore aujourd’hui, l’agriculture n’a pas servi qu’à produire de l’alimentation, mais aussi de l’énergie et des matériaux. »[…]
Perspectives agricoles – Septembre 2024, « L’agrivoltaïsme mise sur les algorithmes », « L’agrivoltaïsme fait face à une contrainte réglementaire majeure : la loi impose le maintien de 90% de la production agricole sous les panneaux. L’investissement requis pour ces installations étant important, l’objectif des industriels est d’optimiser la production électrique tout en maintenant voir améliorant les cultures implantées dessous. « Les premières générations de trackeurs solaires étaient en défaveur de la production agricole, sauf pour la vigne qui avant démarré plus tôt le pilotage agricole », explique Jean-Luc Bochu, responsable de l’activité énergie-agrivoltaïsme chez Solagro. » […]
Voir les publications relatives à la presse Afterres2050